Sarah Vermande fait partie du comité anglophone de la Maison Antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale.
De l’anglais vers le français :
- Tendresse de Matthew Wittet (pièce traduite avec le soutien de Creative Australia et de la Maison Antoine Vites)
- L’oreille humaine de Alexandra Wood (pièce co-traduite avec Dominique Hollier)
- Tranche froide de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier), pièce courte
- Scintillations de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier)
- Never Vera Blue de Alexandra Wood
- Gloire sur la terre de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier)
- Le cimetière de l’éléphante de George Brant (pièce co-traduite avec Dominique Hollier, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez)
- Révolte de Alice Birch
- Sex&God de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier)
- Toutes les cinq minutes de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier, dans le cadre d’une résidence avec l’autrice à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon)
- mauvaise de debbie tucker green (pièce co-traduite avec Gisèle Joly et Sophie Magnuad, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez)
- Ce qu’est l’amour de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier)
- Dossier Incertitudes de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier, à l’initiative de France Culture)
- Un jour ou l’autre de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez)
- Fractures de Linda McLean (pièce co-traduite avec Blandine Pélissier, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, bénéficiaire de l’aide à la création 2010, publiée par Théâtre Ouvert dans la collection Tapuscrits)
- La onzième capitale de Alexandra Wood (pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, bénéficiaire de l’aide à la création 2009, publiée aux Éditions Théâtrales)
- Cette nuit-là de David Farr (avec le soutien de la Maison Antoine Vitez et du British Council)
- Agapes de Moira Buffini (pièce co-traduite avec Isabelle Kérisit)
- Dans le sac de Mark Ravenhill
- Les croyantes de Matthew Hurt
- Chanter ! Danser ! Jouer ! de Matthew Hurt
- Mammifères et autres papillons de Amelia Bullmore (pièce co-traduite avec Dominique Hollier)
- Un raisin au soleil de Lorraine Hansberry (pièce co-traduite avec Samuel Legitimus), publiée chez L’Arche, 2022.
- L’opéra de trois fous, livret et paroles de Mike Dineen, musique de Robin Bullock
- After Liverpool de James Saunders (pièce co-traduite avec Valérie Da Mota)
[voir ci-dessous pour une présentation plus détaillée des textes et de leurs auteurices]
Du français vers l’anglais (en collaboration avec Matthew Hurt) :
- Le mardi à Monoprix d’Emmanuel Darley (crée au Fringe Festival d’Edimbourg en 2011, avec Simon Callow)
- Par la nuit de Jean-Luc Raharimanana (surtitrage pour Laterit Productions / Rotterdam Film Festival)
- Seuls de Wajdi Mouawad (surtitrage pour le Festival d’Avignon)
- Les cauchemars du gecko de Jean-Luc Raharimanana (surtitrage pour le Festival d’Avignon)
- Les inepties volantes de Dieudonné Niangouna (surtitrage pour le Festival d’Avignon)
- Vie et mort d’une parole ordinaire de Laure Salama (pour le International Workshop
Festival)
TRANCHE FROIDE de Linda McLean
(tritre original Cold Cuts)
Pièce courte co-traduite avec Blandine Pélissier

Une femme. Son mari. Un coup d’oeil dans le frigo. Et tout bascule.
Cette pièce courte est un upper-cut qui dénonce, avec la subtilité typique de l’écriture de Linda McLean, les violences conjugales. Les bénéfices des représentations vont à Amnesty International.
SCINTLLATIONS de Linda McLean
(titre original Shimmer)
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier
Trois femmes (Hen, la grand-mère, Missy, la mère, et Petal, la petite-fille) sont contraintes par des pluies torrentielles de descendre du train qui les menait à Oban, étape vers l’île sacrée de Iona, à l’ouest de l’Écosse. Petal est condamnée, mais les deux autres femmes veulent croire au miracle. Elles trouvent refuge dans une maison d’hôtes où sont rassemblés trois hommes sans lien de parenté, de trois générations différentes : Sonny, Jim et Guy. Chacun a été confronté au deuil le plus âpre – le perte d’un enfant, d’une femme, d’une mère. Jim tient l’auberge, Sonny est là en vacances, Guy veut malgré le déluge tenter une improbable escalade. Dans le temps suspendu de l’attente vont se jouer des jeux de miroir et de mémoire entre les trois femmes et les trois hommes qui, sans se connaître, croient pourtant se reconnaître. Trois fois la scène se répète, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et chacun·e, par les liens ténus qu’il ou elle tisse avec les autres, renoue le fil d’un passé douloureux, ou se prépare à l’absence d’avenir.
Une pièce onirique, émaillée d’humour, qui parle du deuil avec un lyrisme pudique, étonnement concret, tendre sans jamais devenir sentimental. Chaque personnage livre, par fragments, un récit intime, dans un jeu subtil portant sur ce qui n’est « en réalité » pas dit à haute voix – le personnage de Petal s’invite maitresse de cérémonie en indiquant au public que ce qu’il a entendu n’a en fait pas été prononcé. Ou si peu. Mais certains personnages, quand ils font vraiment attention, captent sans le savoir un partie de ce discours qui ne leur est pas destiné. Les didascalies aussi s’invitent de plain-pied dans la partie, tout comme la pluie, le lac et les montagnes du décor.
NEVER VERA BLUE de Alexandra Wood
(titre original Never Vera Blue)

Never Vera Blue raconte l’histoire d’une femme qui, au fil de ses années de mariage, en est venue à tellement douter d’elle-même qu’elle n’est plus capable d’affirmer en toute certitude combien elle mesure.
Prisonnière, comme le Petit Chaperon rouge dans le ventre du loup, elle se pose cette question vitale : comment (se) sortir de là ?
Ecrite à la suite d’entretiens avec des survivantes de violence domestique, la pièce trace les méandres, mentales et physiques, d’une femme qui doit se retrouver – savoir à nouveau qui elle est – pour se sauver, dans tous les sens du terme : fuir, et ainsi préserver son intégrité mentale et physique (et celle de ses filles), accepter une guerre ouverte pour échapper à cette autre guerre, plus discrète, plus redoutable aussi peut-être, qu’est la maltraitance psychique.
Dans un monologue pour comédienne virtuose, l’autrice entremêle, sans ménagement mais avec une tension croissante, quatre fils narratifs :
- la situation présente (traitée avec le plus grand réalisme) : la narratrice est prisonnière de ce qui s’avère peu à peu être un estomac
- une relecture du conte du Petit Chaperon-rouge : qu’est-ce qui fait qu’on se jette dans la gueule du loup alors qu’on voit parfaitement les oreilles velues dépasser du bonnet de nuit ? Et de quoi la petite fille et sa grand-mère ont-elles bien pu parler dans le ventre de la bête ?
- l’histoire d’un soldat caché dans une grotte : un film que la narratrice aurait vu il y a longtemps, peut-être ? Ou le moyen qu’elle a trouvé d’exorciser par l’imaginaire sa propre guerre ?
- le fil des souvenirs : dans une alternance de récits et de dialogues au cordeau, sont progressivement dévoilées les manipulations psychiques et l’escalade de la violence, l’air de rien d’abord, puis dans toute leur glaçante subtilité, jusqu’à l’épisode qui déclenche enfin le réflexe de survie et la décision de fuir.
GLOIRE SUR LA TERREde Linda McLean
(titre original Glory on Earth)
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier

 (Atelier Cité-Théâtre de la Cité)
(Atelier Cité-Théâtre de la Cité)
19 aout 1561, 9 heures du matin. Le bateau qui transporte Marie, reine d’Écosse, émerge de la brume dans le port de Leith, aux pieds d’Édimbourg. Marie Stuart a dix-neuf ans, elle est avenante, intelligente, éduquée. Sur ses jeunes épaules reposent les ambitions de l’establishment catholique de l’Europe entière. Mais l’Écosse qui la reçoit a décrété hors la loi son église et ses pratiques, sous l’égide du très radical John Knox, prêtre réformé.
Marie et John se croient tous deux mandés par Dieu, aimés de leur peuple. Tous deux savent d’expérience que l’exil n’est jamais loin.
Ils se parleront lors de quatre entrevues officielles – des rencontres pondérées sur toile de fond orageuse de négociations secrètes et frénétiques avec le véritable pouvoir écossais : une noblesse, riche et liée à la couronne, qui s’entre-déchire violemment depuis des générations. Il s’agit de charmer, de soudoyer, d’intimider ces hommes pour qu’ils choisissent leur vainqueur.
Récit du pas de deux fatal entre une reine jeune et gracieuse et un fanatique intransigeant dans leur lutte pour gagner le cœur et l’âme des Ecossais, Gloire sur la terre raconte surtout deux conceptions de la foi : celle qui veut vivre et laisser vivre, et celle qui ne conçoit de salut pour personne hors de sa vérité.
Linda McLean n’a pas écrit un drame réaliste à jouer en costume d’époque, mais un poème politique pour aujourd’hui.
LE CIMETIERE DE L’ELEPHANTE de George Brant
(Titre original Elephant’s graveyard)
Pièce co-traduite avec Dominique Hollier
Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez
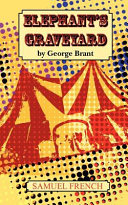
Nous sommes en 1916. Un cirque. Une petite ville du Tennessee. Un mort. Et le seul lynchage connu d’un éléphant dans toute l’histoire des États-Unis.
L’auteur s’empare ici de l’histoire vraie et tragique de la pendaison de Mary, gigantesque éléphante d’Asie, à une grue ferroviaire, après qu’elle a malencontreusement, agacée, écrasé la tête de l’employé de cirque inexpérimenté mais tenace qui la conduisait lors de la parade. George Brant en fait un grand poème choral, où les gens de la ville et les membres du cirque racontent chacun leur morceau d’histoire, pris dans le rythme inéluctable de la tragédie, mais comme s’ils n’arrivaient toujours pas à y croire.
Poème choral à deux chœurs serait-on tenté de dire – villageois et circassiens ; dans chaque chœur, comme répondant à un appel à témoignage, des voix distinctes, variations symphoniques sur un thème tragique – et au centre, la plus présente bien que physiquement absente, Mary, l’éléphante.
Cette grande brute de Mary, qui ne connaît ni bien ni mal, nous renvoie à nos responsabilités d’êtres moraux, soi-disant supérieurs, et qui pourtant ne marchons toujours qu’au pain et au cirque.
REVOLTE de Alice Birch
(Titre original Revolt. She said. Revolt again.)

Dans le cadre de son Midsummer Mischief Festival (un « festival d’espiègleries estivales » pourrait-on dire), la Royal Shakespeare Company a demandé à deux autrices de réagir à la proposition suivante : « les femmes bien élevées (ou bien sages) entrent rarement dans l’Histoire » (ou « font » rarement l’Histoire). La première, Timberlake Wertenbaker, est un monument du théâtre anglais contemporain, la seconde, Alice Birch, est en train de s’y faire une place bien à elle.
Sa dixième pièce, REVOLT. SHE SAID. REVOLT AGAIN, est une réponse radicale à la proposition/provocation de la RSC en forme de texte mal élevé (ou pas sage). Une injonction à faire la révolution. Une pièce très difficile à résumer, de l’aveu même de l’autrice.
Quatre actes de plus en plus brefs déconstruisent la façon dont le langage, les mœurs et les comportements asservissent encore les femmes – et les hommes – au xxie siècle.
Acte 1 : Quatre scènes aux répliques non attribuées proposent respectivement de révolutionner le langage, le monde, le travail et le corps. Des scènes drôles et glaçantes où le système (patriarcal et économique) est attaqué avec une logique implacable.
Acte 2 : Dinah retrouve sa mère qui l’a jadis abandonnée pour lui présenter sa propre fille, en voie de désagrégation. Ça ne fait ni chaud ni froid à la grand-mère. Encore un repas de famille qui dégénère.
Acte 3 : Des paroles sur tous les chevaux de bataille féministes – pornographie, représentation des femmes au cinéma, diktat de la minceur, virginité, humour douteux, place des hommes dans le féminisme, etc – s’entrecroisent dans une sorte de chœur absurde et drôle, redoutablement construit.
Acte 4 : Quatre femmes vont renverser l’ordre établi et éradiquer les hommes. Mais la révolution n’a-t-elle pas déjà échoué ?
L’ensemble forme un objet insolite et stimulant – défi à la traduction, à la mise en scène, à à la capacité du public à accepter d’être bousculé, mais qui n’a rien d’une provocation gratuite. Une exploration sans complaisance des mécanismes de domination, de leur violence et de la violence nécessaire (?) à leur subversion. Alice Birch pose au final la seule question qui vaille : et maintenant, on fait quoi ?
SEX & GOD de Linda McLean
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier
Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez

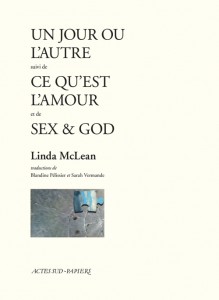
Poursuivant l’expérimentation formelle qui fait d’elle une voix unique de la dramaturgie britannique contemporaine, Linda McLean explore ici une certaine condition des femmes au XXè siècle par l’entrelacs de quatre paroles de femmes, quatre monologues fragmentés qui poussent jusqu’à sa limite l’idée du texte théâtral comme partition musicale.
De la petite servante du début du siècle quittant la campagne pour la ville à l’étudiante contemporaine qui veut voir le monde, en passant par l’épouse maltraitée et l’amoureuse trop fertile pour la société, Linda McLean parle du corps des femmes, du corps qui travaille, du corps qui aime, du corps tantôt approprié tantôt exproprié.
Jane, Lizzie, Sally et Fiona n’appartiennent pas au même temps mais partagent un besoin d’émancipation, physique, économique et symbolique : l’expérience que chacune d’elle fait du sexe, de la maternité, du rapport aux hommes, à la loi et la religion, répond à celle des autres et la prolonge. Chacune dans son époque, mais toutes quatre rassemblées par la convention théâtrale dans l’espace du plateau, elles entendent le récit des trois autres ; en suivant le fil de leur narration propre, elles vont pourtant réagir et d’une certaine façon interagir. Cet étrange chœur-conversation forme un texte à la fois brutal et délicat qui invite le spectateur à se laisser happer et hanter par les mots, comme il s’abandonnerait à la musique d’un quatuor à cordes.
TOUTES LES CINQ MINUTES de Linda McLean
(titre original : Every Five Minutes)
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier

© Magic Theatre /Jennifer Reiley
Mise en scène de Loretta Greco
http://magictheatre.org/
Toutes les cinq minutes retrace un moment d’une soirée entre amis, à moins que ce ne soit le récit de toute une vie. Mo vient de passer dix-sept ans en captivité. Il retrouve sa compagne, Sara, et les fidèles Ben et Rachel, qui, non seulement se sont battus pour sa libération, mais ont élevé leur fille, Molly, dans le souvenir de celui qu’elle a à peine connu. Mais Mo est-il présent ? Est-il encore dans sa prison avec, pour gardiens, deux drôles d’oiseaux aux noms de clown ? Est-il perdu dans ses souvenirs ? Ou dans le fantasme d’un avenir peut-être encore possible ? A quel espace et à quel temps appartiennent ces personnages qui défilent : sa mère, le marchand de charbon, Dieu, un pied, l’agente du recensement ? Quand, pour survivre, un homme passe dix-sept ans dans sa tête, seul espace non-contraint, comment peut-il ensuite ré-habiter le quotidien ? Comment garder prise avec la réalité quand on a subi, des années durant, une forme de torture qui consiste à empêcher ou fractionner à l’extrême le sommeil ? C’est le rêve-cauchemar de cette renaissance – peut-être – auquel nous invite Linda McLean.
Dans le premier acte, la soirée entre amis telle que Mo la vit, avec des glissements hors de la réalité qui l’emmènent rencontrer ses anciens tortionnaires, sa mère, Dieu, ses souvenirs d’enfance etc. Dans le deuxième acte, la soirée telle qu’il aurait dû la vivre s’il avait pu rester « présent ».
MAUVAISE de debbie tucker green
(titre original : born bad)
Pièce co-traduite avec Gisèle Joly et Sophie Magnaud
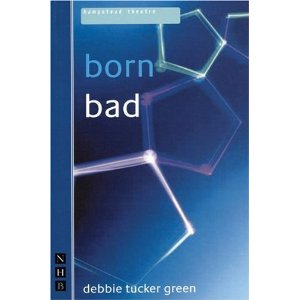

La fille aînée d’une famille noire vient demander des comptes. À sa mère. À ses deux sœurs. À son frère. Et à son père. Il s’agit de nommer ce qui s’est passé pendant l’enfance. Il s’agit de se souvenir. Il s’agit pour elle de retrouver sa place.
Qui savait quoi ? Qui a choisi qui ? Qui peut aujourd’hui le dire ?
Autour de l’inceste du père – qui, malgré l’injonction liminale, « dis-le », ne sera jamais nommé – viennent s’articuler toutes les trahisons, passées et présentes. Celle de la mère : a-t-elle fermé les yeux, pris les devants pour protéger ses autres enfants, ou simplement laissé tomber le fruit pourri ? Celle des sœurs, qui se réfugient pour l’une dans une religiosité amnésique, pour l’autre dans un déni agressif. Celle enfin du frère, la pire trahison de toutes peut-être — avoir été lui aussi victime. Avoir été, peut-être, le préféré.
Loin du décor réaliste d’un drame familial accoudé au formica, le lieu de l’affrontement des personnages est ici la langue même. Présents sur le plateau pendant toute la pièce, dans un espace quasi abstrait, il y a ceux qui parlent et ceux qui se taisent. S’il arrive que les corps se touchent, ou tentent de se toucher, la chair n’a plus sa place là où elle a tout dévasté. Ne restent que les mots pour s’atteindre, se blesser, se prouver que, malgré tout, on existe. Les mots pour que chacun déballe sa vérité, celle qui lui est indispensable pour tenir encore debout. Les mots pour éviter toujours de dire ce qui pourrait pourtant permettre de reconstruire. Car dans cette guerre des subjectivités, le non-dit reste l’arme absolue.
La langue de Debbie Tucker Green emprunte au parler noir de la rue londonienne ses influences jamaïcaines, sa violence urbaine, ses répétitions obsessionnelles. Mais c’est une langue qui s’invente en permanence, ludique et savamment malmenée, lyrique dans sa brutalité, à la fois torrentielle et dégraissée.
Une langue-défi pour le traducteur comme pour l’acteur.
Une langue éminemment théâtrale qui exige d’être dite.
CE QU’EST L’AMOUR de Linda McLean
(titre original : What Love Is)
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier

Ce qu’aimer veut dire est une tranche d’une heure dans la vie d’un couple vieillissant. Gene et Jean savent qu’ils s’aiment encore, à défaut de toujours savoir où et qui ils sont. Ils dansent le tango, se taquinent et partent dans leurs souvenirs. Mais ce soir, leur intimité en rêverie est brisée par le retour inopiné de leur fille Jeanette, de mauvaise humeur sur ses talons hauts, sa soirée gâchée par cette inquiétude sourde : peut-elle, sans risque, laisser deux personnes âgées et fragiles, le temps de se détendre ? C’est que Jeanette est devenue le parent de ses parents : elle travaille la journée, puis rentre s’occuper d’eux. C’est épuisant. Pour elle – comme pour eux. Car Jean et Gene, n’attendent qu’une chose, c’est qu’elle ressorte, qu’elle les laisse à nouveau seuls…
UN JOUR OU L’AUTRE de Linda McLean
(titre original : Any Given Day)
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier
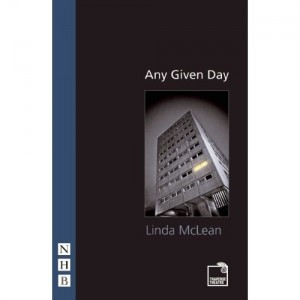
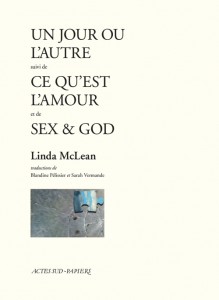
Any Given Day (Un jour ou l’autre) est un diptyque porté par deux styles d’écriture. Ces deux pièces mettent en scène deux mondes différents dont les protagonistes ne se croisent pas et dont la connexion n’apparaît qu’à la toute fin.
Le premier univers est celui d’un couple de déficients mentaux, unis peut-être par un certain désengagement des services sociaux. Accrochés l’un à l’autre, partageant leurs peurs mais aussi leurs minuscules bonheurs, ils vivent seuls en logement social depuis que l’institut spécialisé qui les accueillait a fermé. Isolés dans leurs routines compulsives et cocasses, dans l’attente de “la” visite hebdomadaire de leur nièce, ils se sentent cernés par la menace de l’extérieur.
Terrifiée par le dehors, l’imprévu, le téléphone… Bertha s’accroche à de minuscules rituels. Son rapport plus qu’improbable aux objets et au temps la rend entièrement dépendante de Bill, son compagnon. Celui-ci gère leur quotidien, alternant railleries et réconfort, jouant l’homme fort. Mais il ne sera pas là pour la protéger au moment où l’extérieur fera irruption de la façon la plus violente.
De l’autre côté de la ville, dans un bar à vin à la fin du service de midi, le patron transmet à sa serveuse un message téléphonique de son fils borderline dont elle est sans nouvelles depuis cinq ans. Le patron qui espère profiter de son émotion, ouvre une bonne bouteille et lui propose une escapade au bord de la mer pour fêter ça. S’ensuit un échange verbal cru où alternent confidences et jeu de séduction.
Jackie, la serveuse, a abandonné son ancien métier d’infirmière après la rupture avec son fils. Elle ne se sentait plus les ressources de s’occuper des autres et, en quête d’un travail dénué de responsabilités, elle a atterri dans ce bar. D’abord déconcerté par la verdeur des réparties de Jackie à ses avances, Dave, le patron du bar, tout en se dévoilant seul, fragile et sentimental, persiste dans sa conquête. Jackie finit par se laisser séduire par l’idée d’une escapade, et laisse un message à son oncle en s’excusant d’annuler sa visite hebdomadaire, inconsciente du drame qui se joue ou s’est joué en son absence.
Personnages : 2 femmes et 2 hommes
Traduction vers l’anglais en collaboration avec Matthew Hurt :
TUESDAYS AT TESCO’S d’Emmanuel Darley (titre original : Le mardi à Monoprix)
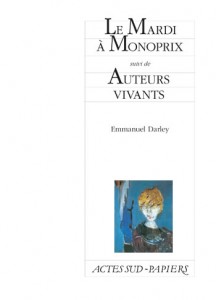
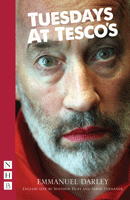
FRACTURES de Linda McLean (titre original : strangers , babies)
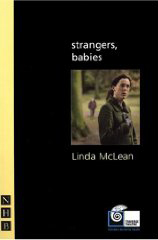
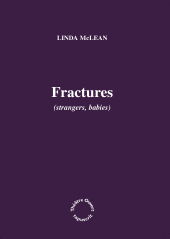
Pièce co-traduite avec Blandine Pélissier, avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, lauréate de l’aide à la création en 2010. Cette traduction a fait l’objet d’une résidence de traduction avec l’auteure à Théâtre Ouvert, en partenariat avec le Traverse Theatre d’Edimbourg et la Maison Antoine Vitez. Elle est publiée par Théâtre Ouvert dans sa collection Tapuscrits, 2011.
May débat avec son mari de l’opportunité de sauver un oisillon échoué sur leur balcon, May rend visite à son père à l’hôpital sans que ça le réjouisse franchement, May effraie un homme rencontré sur internet avec son enthousiasme SM, May effraie son frère en lui disant qu’elle et son mari vont avoir un bébé, May effraie l’envoyé des services de protection de l’enfance venu vérifier que tout se passe bien avec le dit bébé.
En prêtant aux cinq scènes l’ambiguïté de cinq micro-drames indépendants, Linda McLean donne à May une identité fragmentée et au lecteur/spectateur l’intuition que quelque chose, quelque part, a un jour été brisé. On suppose, plus qu’on ne comprend, que May, enfant, a sans doute commis un acte irréparable envers un de ses semblables. Peut-elle dès lors prendre soin de quelqu’un d’autre, prendre soin d’elle-même, jamais? Quand le martyre de l’enfance est d’avoir été bourreau, y a-t-il une rédemption possible ?
Menace et humour sont savamment distillés par l’écriture sobre, subtilement musicale, de Linda McLean et le malaise va croissant.
Personnages : 1 femme et 5 hommes (dont un joue le père de la femme – les autres sont à peu près de sa génération)
Linda McLean a grandi à Glasgow. Enseignante de formation, elle a voyagé en Europe, en Scandinavie, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Elle écrit principalement pour le théâtre et la radio, et travaille actuellement à des commandes du Traverse Theatre et de Magnetic North. Elle intervient régulièrement dans les écoles ainsi que dans des ateliers destinés à de jeunes auteurs pour les encourager à trouver leur voix singulière dans la langue qui est la leur. Elle est présidente du Playwrights’ Studio Scotland et vit actuellement à Berlin.
LA ONZIÈME CAPITALE d’Alexandra Wood (titre original : The Eleventh Capital)
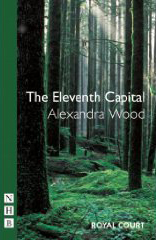

Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, lauréate de l’aide à la création en mai 2009, publiée aux éditions Théâtrales, collection Scènes Étrangères.
Première pièce d’une toute jeune auteure, La onzième capitale se présente comme une variation sur les jeux de pouvoir en régime totalitaire.
Jamais nommée, c’est la Birmanie qui sert ici de référence, une référence rendue explicite par le titre même: en 2005, la junte militaire a en effet décidé de déplacer la capitale de Rangoun (10ème capitale historique) à Pyinmana, petite ville isolée au centre du pays, forçant des centaines de fonctionnaires de ministères clefs à plier bagages en un weekend.
Six scènes passablement glaçantes mettent en scènes des personnages toujours différents mais dont les histoires se recoupent, autour de celle, ainsi racontée en creux, d’un fonctionnaire délocalisé de force : ces duologues (pour la plupart) ressemblent à des parties d’échec aux règles dangereusement mouvantes, aux enjeux à la fois dérisoires et vitaux.
Dans un système fondé sur la paranoïa, manipulation du langage et sadisme psychologique ne sont pas l’apanage exclusif des puissants : à tous les échelons de la société, on n’assure sa survie qu’en assujettissant l’autre – voisin, associé, collègue, « ami ». Pas de rédemption possible quand les bons sentiments sont une arme qu’on retourne contre vous.
En six vignettes implacables qui vont bien au delà du simple exercice de style, Alexandra Wood fait le portrait de la plus terrible des solitudes : celle d’un monde sans fraternité.
Personnages : 5 femmes et 8 hommes (les rôles pouvant facilement être doublés quand c’est nécessaire)
Alexandra Wood est diplômée de l’Université de Birmingham où elle a étudié l’écriture dramatique. Elle a été membre du Young Writers’ Invitation Group au Royal Court Theatre de Londres et est actuellement auteur en résidence au Finborough Theatre. En 2007 le prestigieux Prix George Devine lui a été attribué pour The Eleventh Capital, pièce produite au Royal Court Theatre Upstairs, Londres, et publiée par Nick Hern Books. En 2008 The Lion’s mouth a fait l’objet d’une mise en voix au Royal Court Theatre. Alexandra est en cours d’écriture d’une nouvelle pièce pour le Gate Theatre, Londres.
LES CROYANTES de Matthew Hurt (Titre original : Believe)

(Linda Marlowe, créatrice du rôle)
Rahab. Bethsabée. Judith. Hannah.
La prostituée. L’épouse. La veuve. La mère.
La traitresse, l’ambitieuse, l’héroïne et la martyre.
En revisitant, de façon plus ou moins contemporaine et psychologique, les mythes de ces quatre figures féminines issues du monde sanglant et masculin de l’Ancien Testament, Matthew Hurt ne s’intéresse pas tant à la question de savoir si la guerre est une affaire d’hommes et la foi une affaire de femmes, mais plutôt au mécanisme même de la foi en temps de guerre, quand l’arme la plus redoutable n’est pas forcément celle qu’on brandit au front.
« Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé », dit le dieu de Pascal. Les quatre femmes qui nous parlent ici cherchent et trouvent – mais qui ? Pourquoi ? Et à quel prix ?
Pièce pour 1 comédienne.
Matthew Hurt a été formé comme comédien avant de participer au programme d’accompagnement aux jeunes auteurs lancé par le Soho Theatre à Londres. Il écrit principalement pour le théâtre et la radio. Les deux solo sécrits pour la comédienne britannique Linda Marlowe -Mortal Ladies Possessed, inspiré des nouvelles de Tennessee Williams, et Believe, revisitation toute personnelle de certaines grandes figures féminines de l’Ancien Testament – ont voyagé dans le monde entier. Il collabore avec le compositeur Conor Mitchell pour Have a nice life, comédie musicale primée aux Etats-Unis, et l’opéra Pesach, commande du Irish Arts Council.
Believe est traduite en français, en allemand et en suédois.
AGAPES de Moira Buffini (Titre original : Dinner)

Pièce traduite en collaboration avec Isabelle Kérisit.
C’est un dîner particulier auquel Paige a convié quelques intimes pour fêter le succès du livre de son philosophe de mari, financier reconverti. Chaque plat, quoi qu’immangeable, a été conçu pour en dire long – mais qui aurait envie d’entendre ? A mesure que la soirée avance, le vernis des bonnes manières craque et les masques tombent. La vengeance est un plat qui se mange froid, idéal pour qui aime les desserts glacés.
Cette sombre satire sociale sur les prétentions d’une certaine classe anglaise est construite comme un polar (nuit de brouillard, serveur muet, hôte mystère) avec pour armes du crime des réparties cinglantes qui toujours font mouche. Mais au final, rien ne vaut le couteau. Moira Buffini excelle à embrasser les codes d’un théâtre que nous qualifierions de bourgeois pour les pervertir, tout en renouant avec la cruauté des « comédies de manière » à l’anglaise.
La pièce a été nominée aux Olivier Awards de 2002 comme meilleure nouvelle comédie. Depuis sa création au National Theatre (suivie d’un transfert dans le West End et d’une tournée nationale), elle a fait l’objet de nombreuses mises en scène.
Personnages : 3 femmes, 4 hommes
Moira Buffini est comédienne, metteuse en scène et auteure : elle écrit pour le théâtre et la télévision. Ses pièces, parmi lesquelles Jordan, Gabriel et Silence, lui ont valu de nombreux prix. Membre fondateur du groupe des « monstristes, elle prône un théâtre ambitieux et imaginatif, loin des textes naturalistes à l’esthétique de séries télévisées.
CETTE NUIT-LÀ de David Farr (Titre original : Night of the soul)
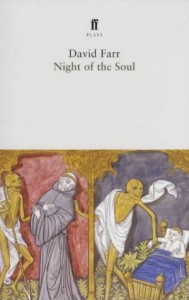
Pièce traduite avec le soutien de la Maison Antoine Vitez et du British Council.
Une jeune femme morte de la peste au XIVè siècle hante un hôtel moderne. Dans l’attente de sa délivrance, Joanna fait le ménage des chambres et regarde des films à la télévision avec les clients. Personne ne la voit ni ne l’entend. Jusqu’au jour où Francis Chappell, responsable marketing toujours sur les routes, revient dans sa ville natale après dix-huit ans d’absence pour y enterrer son père – et affronter sa mère et sa soeur. Quand il voit Joanna, elle voit en lui le salut. Mais encore faudrait-il qu’elle puisse le convaincre d’exorciser le passé. Si la nuit est propice aux confessions, au matin tombera le verdict.
Francis n’a aucune raison de savoir que la jeune et séduisante femme de chambre qu’il trouve dans sa salle de bain est un fantôme à qui personne n’a parlé depuis sept siècles. Il ne sait pas non plus combien elle a besoin de lui, ni à quel point lui-même a besoin d’elle. Pour l’heure, elle est une importune dont il faut se débarrasser.
A partir d’une situation de comédie, dont il tire d’ailleurs pleinement profit, David Farr construit une réflexion sur la faute, la culpabilité et la solitude qui les accompagne. En posant la question des conditions d’une rédemption, il interroge la responsabilité de tout homme envers les autres, certes, mais encore plus envers lui-même.
Personnages : 4 femmes et 3 hommes pour les rôles principaux, et au moins trois autres femmes et 3 autres hommes se partageant les autres rôles.
David Farr est auteur et metteur en scène. Nombre de ses pièces et adaptations ont été montées par la Royal Shakespeare Company et le Royal National Theatre. Il est directeur artistique du Lyric Hammersmith à Londres depuis juin 2005, et parle couramment français !
DANS LE SAC de Mark Ravenhill (Titre original : Handbag)

Londres. Deux enfants vont naître. L’un chez un couple lesbien de la fin du vingtième siècle, l’autre chez un couple traditionnel de l’ère victorienne. Or on sait depuis Oscar Wilde que les bébés ne se trouvent ni dans les roses ni dans les choux mais dans des sacs de voyage, et que c’est là la source de beaucoup de confusion. Le dialogue entre les deux époques s’engage dans un tourbillon de nannies romancières, de pizzas tomate-fromage sans fromage, d’œuvres philanthropiques douteuses et de vidéo-surveillance – et l’on se dépêche d’en rire avant d’avoir à en pleurer.
On retrouve dans cette pièce les traits caractéristiques qui ont fait la gloire sulfureuse de l’auteur de Shopping and fucking : un humour acide, une sexualité et une violence explicites, des individus perdus dans l’environnement glacé de la technologie moderne et de la société de consommation. Mais Ravenhill creuse ici d’une façon originale les thèmes de l’identité sociale et de la dépendance – à la drogue, certes, mais encore et surtout à autrui – et qui est alors le plus dépendant : celui qui a besoin de l’autre, ou celui qui a besoin que l’autre ait besoin de lui ? La construction en allers-retours entre l’époque contemporaine et l’époque victorienne, et le jeu de références à L’Importance d’Etre Constant de Wilde, donnent un caractère éminemment ludique à un texte qui pose par ailleurs de façon grave les questions du choix de la parentalité et de la responsabilité qu’il implique.
Cette pièce a valu à Mark Ravenhill le Evening Standard Award de l’auteur le plus prometteur de l’année en 1998.
Personnages : 5 hommes – 6 femmes
(NB : la pièce peut être jouée par 3 comédiens et 3 comédiennes)
Mark Ravenhill est des auteurs phares de la génération de dramaturges britanniques à avoir émergée dans les années 1990. Sa pièce Shopping and Fucking lui a valu une renommée instantanée et internationale. Dans les années 2000, il s’est tourné vers une forme plus expérimentale d’écriture. Il professe néanmoins un grand respect pour le théâtre « historique » et déplore que l’attention que les metteurs en scène portent aux écritures émergentes les enferme parfois dans un « éternel présent ». Il écrit également pour le quotidien britannique The Guardian.
DOMMAGES de Steve Thompson (Titre original : Damages)

Construite comme un thriller en temps réel, Dommages pose la question de la morale de la Presse – d’une certaine Presse en tout cas – et celle du droit au respect de la vie privée que peuvent encore avoir ceux qui ont « choisi » la célébrité. À partir d’une situation très simple – un jeune rédacteur en chef aux dents longues publiera-t-il ou non la photo dénudée d’une star de la télévision – l’auteur nous entraîne dans une spirale de retournements où dilemmes professionnels et dilemmes personnels sont étroitement imbriqués.
Personnages : 1 femme et 3 hommes
Steve Thompson a été formé à l’écriture dramatique à la Royal Academy of Dramatic arts. Sa première pièce, Dommages, a été écrite avec le soutien de la fondation Peggy Ramsay. Représentée au Bush Theatre en 2004, elle a gagné le prix Meyer-Whitworth. Steve est devenu auteur en résidence au Bush Theatre en 2005. Il écrit également pour la télévision. Sa seconde pièce, Whipping it up, est une satire politique dont le succès au Bush Theatre a été suivi d’un transfert dans le West End.
MAMMIFÈRES ET AUTRES PAPILLONS d’Amelia Bullmore (Titre original : Mammals)
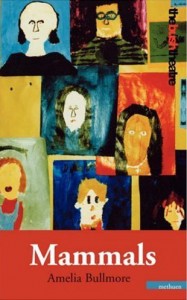
Pièce traduite en collaboration avec Dominique Hollier
Amelia Bullmore, par ailleurs comédienne, écrit pour la télévision. Mammals, sa première pièce, a été finaliste du prix de la meilleur comédie décernée par le magazine What’s On et a remporté le Susan Smith Blackburn Prize.
CHANTER ! DANSER ! JOUER ! de Matthew Hurt (Titre original : Singing! Dancing! Acting!)

Une jeune femme, serveuse dans une pizzeria à Londres, raconte ses espoirs déçus de percer dans la chanson. En attendant le début d’une émission télévisée, une ancienne show girl devenue auteur à succès revient sur sa vie et sur le destin tragique de sa fille, promise à une brillante carrière de danseuse étoile avant qu’un accident ne la rende infirme. Au fin fond de l’Afrique, un homme évoque la carrière d’acteur qu’il a laissé derrière lui, et son attachement à un tout jeune garçon du village.
Tout ce qui brille n’est pas de l’or : c’est avec humour et tendresse, mais sans complaisance, que Matthew Hurt raconte dans ce triptyque de monologues la cruauté des rêves qui se brisent, ou qui pourrissent doucement dans les anti-chambres et arrière-salles du show-business. Il ne s’agit pas des coulisses de la Star Academy ou autre Ferme des Célébrité, mais du monde, plus désuet et sans doute plus attachant, des petits cabarets, des débuts au théâtre, de la grande époque de Pigalle. À travers la fascination pour le monde du spectacle, ses paillettes et la gloire qu’il promet, c’est de l’ambition humaine la plus essentielle qu’il est ici question : être aimé. Tandis que les trois personnages semblent se livrer à cœur ouvert, ils ne sauraient pourtant oublier qu’ils ont été, ou ont aspiré à être, des gens de scène : la confession de leur renoncement à chanter, danser, jouer est encore un moyen de s’attacher un public, avec peut-être aussi l’espoir que s’ils parviennent à convaincre leur auditoire de leur sincérité, ils auront eux-mêmes une chance de croire à celle-ci.
Personnages : 2 femmes et 1 homme
Matthew Hurt a été formé comme comédien avant de participer au programme d’accompagnement aux jeunes auteurs lancé par le Soho Theatre à Londres. Il écrit principalement pour le théâtre et la radio. Les deux solo sécrits pour la comédienne britannique Linda Marlowe -Mortal Ladies Possessed, inspiré des nouvelles de Tennessee Williams, et Believe, revisitation toute personnelle de certaines grandes figures féminines de l’Ancien Testament – ont voyagé dans le monde entier. Il collabore avec le compositeur Conor Mitchell pour Have a nice life, comédie musicale primée aux Etats-Unis, et l’opéra Pesach, commande du Irish Arts Council.
Singing ! Dancing ! Acting ! a été numéro un dans la sélection des critiques du Times lors de sa création à Londres et a récemment remporté un grand succès à Athène.
UN RAISIN AU SOLEIL de Lorraine Hansberry (Titre original : A Raisin in the sun)


Pièce traduite en collaboration avec Samuel Légitimus
Première pièce écrite par une femme noire à avoir été montée à Broadway (1959), Un raisin au soleil demeure un classique absolu du répertoire théâtral américain et a donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques ainsi qu’à une comédie musicale, Raisin!
On y voit la famille Younger, famille noire du fameux « Quartier Sud » de Chicago, se débattre avec ses rêves : pour Mama, la matriarche, maintenir l’intégrité de sa famille, pour Walter Lee, le fils, ouvrir un commerce d’alcool, pour Benethea, la fille, devenir une médecin émancipée. Mais les rêves des Noirs ont-ils même valeur que les rêves des Blancs dans l’Amérique des années 1950 ? Quand la famille envisage de déménager dans un quartier blanc, les aspirations des uns et des autres se heurtent de front à la réalité sociale et raciale de l’époque, mais les rêves servent-il à nous faire patiemment plier ou à affirmer notre humanité ?
AFTER LIVERPOOL de James Saunders (Titre original : After Liverpool)

Pièce traduite en collaboration avec Valérie Da Mota.
After Liverpool ? Ni football, ni Beatles, ni crise des dockers. Simplement un couple, aujourd’hui. Et toujours cette fameuse pomme : pomme d’amour, pomme de discorde… Ou pomme pourrie ? Les rapports humains ne se sont pas simplifiés depuis Adam et Eve, et c’est avec une élégance et un humour tout britanniques que James Saunders s’amuse à les décortiquer. De la simple question « Tu veux une pomme ?» aux tentatives désespérées pour « communiquer », tout n’est que grains de sable dans les rouages de l’amour.
James Saunders (1925-2004) se découvre auteur dramatique dans les années cinquante. Il fait partie de cette génération que la représentation, à Londres, de La Cantatrice chauve et de En attendant Godot, électrise et libère des contraintes formelles de la dramaturgie traditionnelle. Il est primé en 1962 pour La prochaine fois je vous le chanterai, qui l’établit comme l’un des principaux hérauts du Théâtre de l’Absurde en Angleterre, mais ce n’est qu’en 1964 qu’il décide de se consacrer à plein temps à l’écriture. Il écrit pour le théâtre, mais aussi pour la radio, la télévision et le cinéma. Si certaines de ses pièces, comme Bodies (1976), connaissent un grand succès dans le West End et le théâtre dit commercial, il reste fidèle à un travail plus expérimental avec le « Fringe theatre » et ses salles souvent plus petites, hors du centre de Londres, terrain privilégié du théâtre d’avant-garde.
« Je tends à décrire les gens de la « classe moyenne », c’est-à-dire les gens qui ont la chance, ou si l’on veut le malheur, de pouvoir s’intéresser aux dilemmes théoriques, plutôt que pratiques, du quotidien ».
